Genèse de la notion de délibération chez Aristote
Version complétée en Septembre 2025
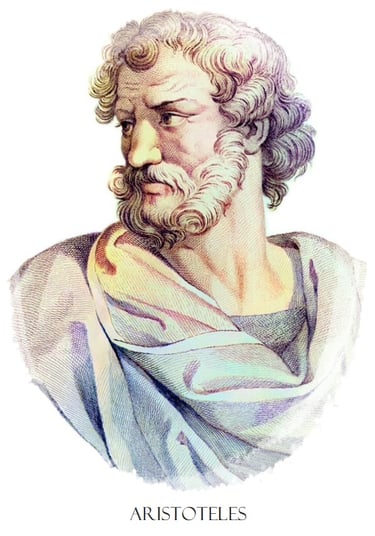
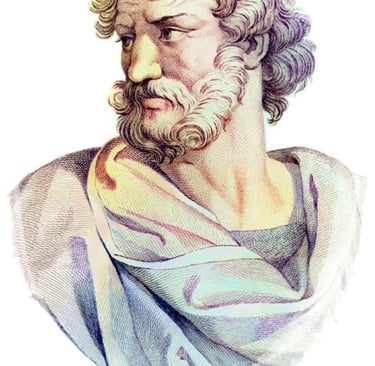
DELIBERATION6
Qu’est-ce que la délibération ?
D’après Littré c’est « l’examen à plusieurs et par la parole touchant une résolution à prendre »
« A plusieurs et par la parole ».
C’est-à-dire par l’échange de paroles. Thucydide a fait faire à Périclès un éloge de la parole qui est un éloge de la délibération : « La parole n’est pas à nos yeux un obstacle à l’action : c’en est un, au contraire, de ne s’être pas d’abord éclairé par la parole avant d’agir. » Cet éloge fut repris et amplifié par Isocrate : après avoir reconnu que les hommes sont sur bien des points inférieurs aux animaux, il rappela qu’en revanche avec la parole ils avaient reçu « le pouvoir de [se] convaincre mutuellement», et que c’était là l’origine du progrès qui les avait conduits à la civilisation.
Certes, beaucoup aujourd’hui ne considèrent plus que la « parole » ni donc la délibération soient le propre de l’homme. Ainsi Pascal Picq a décrit le comportement de babouins mâles hamadryas qui « se livrent à des échanges afin de décider quelle direction prendre pour aller chercher des nourritures lors des saisons sèches » : « Ils se regardent les uns les autres, l’un esquisse un mouvement dans une direction, un autre dans une autre direction, jusqu’à ce qu’une décision reçoive l’assentiment de tous ». Picq estime qu’on peut parler « d’échanges d’avis» et rapproche ce comportement d’une délibération. Avant lui Lorenz a décrit le comportement d’une troupe de choucas, partagée entre les appels kyou (« reviens au bercail ») et kya (« pars avec nous ») : ils atterrissent dans un champ, repartent, tournent en rond, réatterrissent, et cela une douzaine de fois jusqu’à ce que l’un des deux cris l’emporte. Ne faut-il pas tirer de cette description la même conclusion de Picq ?
Nullement. Car il est probable, d’après Lorenz lui-même, que les cris des choucas ne font qu’exprimer leur humeur subjective, ils ne chercheraient pas à s’influencer réciproquement par leurs cris et la décision finale ne serait que l’effet d’une contagion, analogue à celle du rire ou du bâillement chez l’homme. Quant aux babouins, peut-être cherchent-ils à s’influencer, mais dès lors qu’il n’y a pas « d’échanges d’idées » on ne peut rapprocher leur comportement d’une délibération, Soit ! mais, objectera-t-on, il y a chez les abeilles un langage objectif, Karl von Frisch a établi qu’elles se communiquent les unes aux autres la direction et la distance des fleurs qu’elles butinent. Et Martin Lindauer a décrit le comportement d’abeilles qui doivent essaimer : des exploratrices viennent annoncer les résultats de leurs recherches d’un nouveau gîte à l’ensemble de l’essaim – vingt ou trente mille individus qui, en quelques heures, se trouvent devant des dizaines de propositions qui leur font connaître la direction, la distance et la plus ou moins bonne qualité de ces gîtes possibles au moyen de diverses sortes de « danses ». Des ouvrières s’envolent alors vers les gîtes les plus recommandés et, à leur retour, dansent comme les premières. Quand toutes les abeilles dansent de la même façon, l’essaim s’envole d’un coup, le gîte à été choisi. Ne s’agit-il pas, cette fois, de quelque chose qui ressemble à nos délibérations ? Non, car en réalité « il n’y a pas eu de discussion, aucune abeille n’a donné des arguments pour faire changer d’avis d’autres abeilles, car celles qui indiquaient un gîte de troisième catégorie ne disaient pas qu’il fallait le choisir […] et aucune opinion n’a été contestée » ? Si le langage des abeilles est objectif, il est cependant trop restreint, parce qu’inné, pour permettre une représentation, et, à plus forte raison, une discussion.
« Examen par la parole …», la formule est toutefois un peu elliptique. Disons donc plutôt que délibérer, c’est énoncer explicitement les différentes hypothèses au sujet de ce qu’on doit faire, et les divers arguments pour ou contre chacune de ces hypothèses.
Mais il faut ne pas oublier de préciser « … touchant une résolution à prendre », cela est effectivement essentiel. Sinon il s’agirait d’une discussion. Une discussion peut être désintéressée, pas une délibération. Notons à ce propos que celui qui décide peut être distinct de ceux qui énoncent les arguments en faveur des hypothèses. C’est ainsi qu’un roi consulte des conseillers, mais c’est lui seul qui décide, de même un juge entend le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de l’avocat, mais c’est lui seul qui condamne ou absout ; tandis que dans une assemblée démocratique ou dans un jury tous peuvent donner leur avis et tous, à la fin, votent.
« Examen à plusieurs » C’est le sens originel, et c’est encore le plus courant : « Dans son sens le plus courant, la délibération s‘effectue à l’intérieur d’un dialogue dans lequel les interlocuteurs opposent les différentes thèses relatives à une question donnée… » Mais « en philosophie, la délibération désigne le plus souvent un débat intérieur, par lequel la conscience prend une décision après avoir considéré plusieurs possibilités. » Le second sens dérive du premier. Dans l’Ethique à Nicomaque Aristote, après avoir formé la notion de la « débat intérieur », rappelle incidemment l’origine politique de cette notion, et que « la délibération avec soi-même est la forme intériorisée de la délibération en commun, du symbouleunein, telle qu’elle se pratiquait, sinon dans l’Assemblée du peuple, du moins dans le Conseil des hommes d’expérience. » De fait, on traduit par « délibération » ce qu’Aristote appelait la boùleusis et le mot Boulè désignait « dans la démocratie athénienne, le Conseil des Cinq-Cents, chargé de préparer par une délibération préalable les décisions de l’Assemblée du peuple » - « le Conseil délibère, le peuple choisit ou du moins ratifie. » Déjà chez Homère la Boulè désignait « le Conseil des Anciens » et c’est d’ailleurs à cette « ancienne forme de gouvernement » que renvoie Aristote. Comme l’a fait remarquer Jacqueline de Romilly, « émerge déjà chez Homère un trait […] qui ouvre directement sur les tendances [ultérieures : les hommes tendent, de toutes leurs forces, à atteindre des solutions sages par le débat en commun et par l’examen à plusieurs. » Ce n’est donc pas un hasard si l’intériorisation de la délibération commence avec Homère, chez qui les héros sont dits « délibérer dans leur cœur » comme délibèreraient les membres d’une assemblée. C’est ainsi qu’au vingt-et-unième chant de l’Iliade délibère Agénor lors de la déroute des Troyens : doit-il fuir avec les autres ? doit-il fuir en sens inverse, vers l’Ida ? Ayant énoncé ces possibilités, il s’écrie :
Mais à quoi bon, mon cœur, ainsi délibérer ? »
Il se dit en effet qu’aucune fuite ne peut le sauver et il décide donc d’affronter Achille. C’est encore ainsi qu’au chant suivant, après la déroute, Hector délibère devant la porte de Troie, attendant Achille : ne devrait-il pas rentrer dans la ville ? Il renonce à cette première possibilité parce qu’il craint d’y devoir affronter les reproches justifiés de Polydamas d’avoir conduit l’armée à une défaite prévisible. Il envisage alors la possibilité de déposer ses armes et d’aller supplier Achille d’accepter la paix, et il imagine un moment tout ce qu’il pourrait lui offrir. Il s‘écrie alors :
Mais à quoi bon, mon cœur, ainsi délibérer ? »
Car, se dit-il, s’il le rencontre désarmé Achille le tuera sans pitié. Mieux vaut donc combattre. C’est ainsi, enfin, qu’au vingtième chant de l’Odyssée, Ulysse, arrivé chez lui déguisé en mendiant, et voyant, la nuit venue, ses servantes se préparer à rejoindre les prétendants qui se sont installés dans sa maison, délibère s’il doit se précipiter pour les tuer ou attendre une meilleure occasion :
Son esprit et son cœur ne savaient que résoudre.
Allait-il se jeter sur elles, les tuer ?
Ou, pour le dernier soir, laisserait-il encore
Ces bandits les avoir ? Tout son cœur aboyait. »
Mais frappant sa poitrine, il gourmande son cœur :
Patience, mon cœur !…
Et il se rappelle à lui-même une situation analogue, dont il ne se tira que pour avoir temporisé C’est ainsi qu’il parlait, s’adressant à son cœur.
Son âme résistait, ancrée dans l’endurance,
Pendant qu’il se roulait d’un côté et de l’autre,
Méditant les moyens d’attaquer, à lui seul, cette foule éhontée. »
Si Homère utilise le verbe « délibérer », boulenein, pour désigner la réflexion d’Ulysse qui le retient d’agir immédiatement c’est toutefois « Aristote [qui] est le premier à utiliser [le mot « délibération »] dans un sens technique. » Il le fait dans le troisième livre de l’Ethique à Nicomaque dans lequel il expose sa « doctrine du vice », signalant incidemment qu’elle peut être « utile aux législateurs pour fixer les […] peines ». Il y critique la doctrine de Socrate et d’abord celle qu’Euripide expose dans ses tragédies. Il ressort de celles-ci que les hommes sont les jouets de leurs passions, qu’elles les entraînent malgré eux à des actes dont on ne saurait les regarder comme responsables. C’est ainsi que sont excusés l’infidélité d’Hélène de Sparte qui trahit son époux Ménélas pour suivre Pâris (cf. Andromaque, Les Troyennes), l’inceste de Phèdre qui déclare son amour à son beau-fils Hippolyte (cf. Hippolyte), et les crimes de Médée qui tue ses enfants pour se venger de l’infidélité de leur père Jason (cf. Médée). Quant à Socrate, il soutient lui aussi que « nul n’est méchant volontairement », sauf qu’à la différence d’Euripide, il invoque non la contrainte mais l’ignorance du bien, il suffit donc d’en instruire le prétendu « méchant ». Ainsi, un voleur ne ferait que surestimer la valeur des biens matériels et il ignorerait le bonheur que lui procurerait l’étude de la géométrie. Contre Euripide et contre Socrate, Aristote soutient qu’ on est vicieux de son plein gré. Dans le but de l’établir, il élabore la notion de « décision » (traduction de Gauthier et Jolif), de « choix préférentiel » (traduction J. Tricot) - le terme, proairesis, était alors assez « rare et au sens indécis ». Prendre une décision, c’est quelque chose de plus qu’agir de son plein gré. Car « agir de leur plein gré, les enfants et les animaux le peuvent tout aussi bien que l’homme, mais [ils ne peuvent pas] prendre une décision. » On ne saurait parler de « décision » à propos des actes des héros d’Euripide, qui sont seulement poussés par la colère ou par le désir. Mais alors qu’est-ce, positivement, qu’une décision ? Aristote répond qu’elle suppose « délibération », c’est-à-dire « logos » et « dianoïa ». Gauthier et Jolif traduisent : « calcul et réflexion », Tricot : « raison et pensée discursive ». Peut-être faudrait-il traduire logos par « langage », car Aristote vient de dire que les animaux ne sont pas capables de prendre une décision. Mais pourquoi en sont-ils incapables ? Ce n’est pas faute d’intelligence, ils en font souvent preuve, c’est, comme on l’a vu supra, faute de langage. Car « délibérer, c’est d’abord réfléchir » et la réflexion (c’est-à-dire « l‘attention à ce qui est en nous », ce que Descartes appelle la conscience, implique, comme l’a récemment démontré Francis Kaplan, la parole : « On ne peut prendre conscience d’un état de conscience sans se le dire », « la conscience de soi se confond […] avec ce que je me dis. » On ne peut examiner une action possible qu’en en prenant conscience et on ne peut en prendre conscience qu’en la verbalisant – qu’en « délibérant dans son cœur ».
Nous ne délibérons pas sur l’ordre du monde ni sur la diagonale du carré, « nous ne délibérons que sur ce que nous pouvons faire » - sur ce que nous pouvons faire, nous et non pas d’autres. Or dans une action, Platon, dans le Gorgias, avait longuement distingué la fin et les moyens. Pour Aristote, nous ne délibérons que sur les moyens que nous avons de faire ce que nous pouvons faire. Par exemple, « [le médecin et l’orateur] ayant posé la fin (guérir, persuader), examinent comment, c’est-à-dire par quels moyens elle sera réalisée. » Autrement dit, « l’action est la conclusion d’une sorte de syllogisme dans lequel le souhait de la fin joue le rôle de majeure et la détermination du moyen celui de mineure.» Autrement dit encore, c’est l’intellect qui décide, il décide comme dans Homère le « Conseil des Anciens » décidait et annonçait à l’assemblée ce qu’il avait décidé. Comme on voit, même s’il critique Socrate, Aristote conserve beaucoup de son intellectualisme.
« Si l’on tombe sur quelque chose d’irréalisable, on s’arrête », ainsi Ulysse renonce à tuer tout de suite les servantes. Si la chose est réalisable, deux cas se présentent : « S’il se révèle possible d’obtenir la fin souhaitée par plusieurs moyens, [on] examine par lequel elle le sera le plus facilement et le mieux. Si au contraire elle ne peut être accomplie que par un seul moyen [on] examine comment elle sera obtenue par ce moyen, et ce moyen lui même, par quel moyen on l‘obtiendra…» Aristote donne un exemple de ce second cas dans la Métaphysique (Z 7): soit le but souhaité, la santé, la délibération découvrira que la santé est produite par l’équilibre des humeurs, que cet équilibre est produit par la chaleur, et que la chaleur peut être produite par la friction. Or il est immédiatement en notre pouvoir de frictionner, nous frictionnons, la friction produit la chaleur qui produit l’équilibre des humeurs qui produit la santé.
Aristote revient à la délibération dans le septième livre de l’Ethique à Nicomaque, lorsque, après les vertus morales, il examine les vertus intellectuelles : il définit alors la phronesis, ce qu’on appelle la prudence, comme la vertu de « bien délibérer ». On demandera ce que cela peut vouloir dire, concrètement, « bien délibérer ». Cela peut consister, entre autres, à envisager toutes les possibilités. Par exemple, peut-être que Hector ne délibère pas « bien », lorsqu’il décide d’affronter Achille plutôt que de la supplier. Car il exclut la première possibilité : rentrer dans les murs de Troie, quitte à subir les reproches justifiés de Polydamas. Surtout, il ne délibère pas bien – il ne délibère pas lors de l’assemblée où il néglige un présage divin et rejette l’avis de Polydamas. « Prisonnier de l’instant, stimulé par l’offensive, il n’est plus en mesure d’écouter les conseils de Polydamas. »
La conception aristotélicienne de la délibération a été contestée de plusieurs points de vue.
Aristote distingue le cas où il y a un moyen et celui où il y en a plusieurs, et comme on l’a vu, il privilégie le premier cas, qui l’amène à comparer la délibération avec l’analyse mathématique. Mais on peut se demander avec Aubenque « si ce cas privilégié trouve souvent son application dans les affaires humaines, par exemple « dans les affaires de médecine ou les questions d’argent ». Et – toujours d’après Aubenque - ce n’est que dans le second cas qu’on peut vraiment parler de délibération : « C’est ici que trouvera son emploi la délibération, puisqu’il s‘agira de savoir, ou plutôt de prévoir, non de science, mais d’opinion, l’efficace respective des moyens possibles et aussi les risques de causalité adjacente et parasite qu’ils comportent. Ici la mathématique […] du moins la mathématique grecque […] ne sera d’aucun secours. L’homme en sera réduit aux conjectures et c’est seulement en comparant des conjectures qu’il devra rechercher, parmi les moyens possibles, quel est le plus rapide et le meilleur. »
Contre Plaron Aristote soutient que nous n’avons pas le pouvoir de choisir nos fins : « On délibère non sur les fins, mais sur les moyens » « On ne choisit pas la bonne santé, mais de se promener […] en vue de la santé. » Aristote souligne ainsi que la qualité d’une action se mesure non seulement à la rectitude de l’intention (comme le croyait Platon) mais aussi à la convenance des moyens. La volonté de la fin et le choix des moyens se voient donc accorder une égale importance, ce qui est déjà une innovation par rapport au platonisme. Mais Aristote va même parfois plus loin, en laissant percer un jugement de valeur inverse du jugement platonicien. » Parlant du vicieux, il dit ainsi qu’« il ne suffit pas de le vouloir (de le souhaiter) pour cesser d’être injuste et de devenir juste ». Jean Laporte a cependant considéré que le choix des moyens ne suffit pas à caractériser la délibération : « Il faut distinguer deux sortes de délibération : l’une où, la fin étant d’avance fixée de façon précise, la question porte seulement sur les moyens à employer, l’autre où l’on est d’abord indécis entre plusieurs fins, la véritable fin, même, parfois, ne se dégageant qu’au terme. La première, à laquelle convient bien le schéma d’Aristote, est moins délibération qu’enquête, solution intellectuelle d’un problème. » Mais Laporte estime qu’il est rare que la fin soit déterminée assez précisément pour n’autoriser, dans le choix des moyens, que la référence à un seul point de vue, « Or dès que je me place à plusieurs points de vue, j’aperçois plusieurs fins, donc plusieurs rapports de moyens à fin, donc plusieurs syllogismes pratiques, et c’est la comparaison de ces divers syllogismes qui constitue la délibération proprement dite. » Considérons Hector au pied du rempart de Troie : il ne délibère pas que du moyen de sauver sa vie, il délibère pour savoir s’il doit sauver sa vie, ou bien son honneur.
D’après Aristote, c’est l’intellect qui décide. On l’a mis en doute. « Le résultat d’une délibération [serait] fixé d’avance et toute délibération [viserait] en fait à légitimer une décision déjà prise ». Ce serait vrai dans les assemblées - dans lesquelles un Polydamas pourra parler, mais il ne sera jamais entendu. Ce serait aussi vrai des « débats intérieurs ». Telle fut l’idée des « moralistes français ». La Rochefoucauld assura que « la raison est toujours la dupe du cœur. » Et Pascal souligna de même la puissance du sentiment : « M. de Roannez disait : « Les raisons me viennent après, mais d’abord la chose m’agrée ou me choque sans en savoir la raison et cependant cela me choque par cette raison que je ne découvre qu’ensuite. » Mais je crois, non pas que cela choquait par ces raisons qu’on trouve après, mais q’on ne trouve ces raisons que parce que cela choque. » « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, on le sait en mille choses… » « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment… » Dans le même sens Bergson a rappelé que si nous nous examinons scrupuleusement, « nous verrons qu’il nous arrive de peser des motifs, de délibérer, alors que notre résolution est déjà prise. Une voix intérieure, à peine perceptible, murmure : « Pourquoi cette délibération ? tu en connais l’issue, et tu sais bien ce que tu vas faire. »... » Pourquoi cette délibération ? La réponse de Bergson, c’est que « l’intervention brusque de la volonté est comme un coup d’état dont notre intelligence aurait le pressentiment, et qu’elle légitime à l’avance par une délibération régulière. » Nos délibérations ne seraient que ce que le psychanalyste Ernest Jones a appelé une « rationalisation ». Considérons encore une fois le cas d’Hector : il croit délibérer, mais en fait il a déjà décidé d’attendre Achille.
Antonio Damasio a récemment prolongé cette critique. dans L’Erreur de Descartes– erreur qui serait la même que celle d’Aristote. Il souligne moins la puissance du sentiment que l’impuissance de la délibération rationnelle : « Si [pour faire un choix] vous ne disposez que [de la raison], vous ne pouvez pas mener à bien votre raisonnement. [Car] dans le meilleur des cas, il vous faudra un temps extrêmement long pour arriver à prendre une décision […] Dans tous les autres cas, vous n’arriverez pas à prendre une décision du tout, parce que vous allez vous perdre dans vos calculs. » Pourquoi ? C’est que « les processus d’attention et de mémoire n’ont qu’une capacité limitée. » Bref, « au bout du compte, si votre fonctionnement mental ne peut accomplir que [des] calculs rationnels, vous allez être conduit à une décision erronée […] ou bien, exaspéré, vous allez abandonner. » Cependant nous sommes capables de prendre des décisions – et de bonnes décisions – assez rapidement. « S’il en est ainsi, c’est que [le cerveau] doit disposer de quelque chose d’autre que du pur raisonnement. » Ce « quelque chose d’autre », ce sont, d’après Damasio, des « marqueurs somatiques », c’est-à-dire des émotions. Par exemple la peur « peut permettre de rejeter immédiatement une action donnée et vous engager à envisager d’autres alternatives, [elle peut] vous préserver contre des pertes futures, sans plus de délibération. » La puissance de ce que les moralistes français appelaient « le cœur » ou « le sentiment » est donc, pour Damasio, positive. Mais, si sa critique porte contre l’intellectualisme de Platon ou de Descartes, elle porte moins contre Aristote qui sait que le sage en est réduit aux conjectures et qui, contre eux, soutient l’impuissance de toute science. D’autre part Damasio lui-même n’exclut pas la délibération rationnelle : « Les marqueurs somatiques ne permettent sans doute pas, à eux seuls, d’effectuer la totalité du processus de décision chez l’homme normal, puisque les étapes de raisonnement et de sélection finale doivent encore prendre place dans la plupart des cas. » « [Le signal] vous conduit ainsi à choisir parmi un grand nombre d’alternatives. Il est encore possible de pratiquer des analyses en termes de coût/bénéfice et d’appliquer la démarche déductive appropriée, mais seulement après que l’étape du signal a réduit considérablement le nombre des options envisageables. »
Enfin, plusieurs philosophes modernes ont rejeté l’image de l’âme humaine qu’impliquait l’idée de délibération. Nous délibérons tout en sachant que notre décision est déjà prise. Pourquoi ? « Il semble que nous tenions à sauvegarder le principe du mécanisme et à nous mettre en règle avec les lois de l’association des idées. » Mais « le point de vue même où l’associationnisme se place […] implique une conception défectueuse du moi, et de la multiplicité des états de conscience. [Car] le déterminisme associationniste se représente le moi comme un assemblage d’états psychiques, dont le plus fort exerce une influence prépondérante et entraîne les autres avec lui. […] Le désir, l’aversion, la crainte la tentation sont présentés […] comme choses distinctes. […] On s‘expose cependant ici à une confusion grave qui tient à ce que le langage n’est pas fait pour exprimer toutes les nuances du sentiment intérieur. […] C’est une psychologie grossière, dupe du langage, qui nous montre l’âme déterminée par une sympathie, une aversion ou une haine comme par autant de forces qui pèse sur elle. Ces sentiments, pourvu qu’ils aient atteint une profondeursuffisante, représentent chacun l’âme entière, en ce sens que tout le contenu de l’âme se reflète en chacun d’eux. Dire que l’âme se détermine sous l’influence de l’un quelconque de ces sentiments, c’est donc reconnaître qu’elle se détermine elle-même. » Cette critique de Bergson a été reprise par les existentialistes. C’est ainsi que Karl Jaspers nie qu’il y ait « jamais devant moi, en tant qu’existantes, deux voies que je pourrais reconnaitre et entre lesquels je pourrais choisir. Se présenter ainsi les choses c’est faire tomber dans la sphère de l’objectivité ankylosée ce qui est vie existentielle » Sartre a de même longuement critiqué l’idée de délibération : « La volonté n’apparaît-elle pas comme la décision qui succède à une délibération au sujet […] des motifs. Mais on caractérise le motif « comme une appréciation objective de la situation ». Or « cette appréciation objective ne peut se faire qu’à la lueur d’une fin présupposée. » « Loin donc que le motif détermine l’action, il n’apparaît que dans et par le projet d’une action… » « De cela résulte que la délibération volontaire est toujours truquée. Comment, en effet, apprécier des motifs […] auxquels précisément je confère leur valeur avant toute délibération et par le choix que je fais de moi-même ? L’illusion vient de ce qu’on s’efforce de prendre les motifs […] pour des choses entièrement transcendantes, que je soupèserais comme des poids et qui possèderaient un poids comme une propriété permanente, cependant que d’autre part on veut y voir des contenus de conscience, ce qui est contradictoire. En fait [les] motifs […] n’ont que le poids que mon projet, c’est-à-dire la libre production de la fin […], leur confère. Quand je délibère, les jeux sont déjà faits. Et si je dois venir à délibérer, c’est simplement parce qu’il entre dans mon projet originel de me rendre compte [de mes] mobiles par la délibération. » Merleau-Ponty fut d’accord avec la critique sartrienne : « En réalité la délibération suit la décision. C’est une décision secrète qui fait paraître les motifs et on ne concevrait même pas ce que peut être la forme d’un motif sans une décision qu’il confirme ou contrarie. »
Jean Laporte au contraire est resté d’accord avec Aristote : « Il n’y a choix, à strictement parler, que là où l’action est faite en connaissance de cause, et après examen du pour et du contre. » Et il a défendu la conception aristotélicienne contre les critiques de Bergson et des existentialistes : « Malgré tout, le sentiment intérieur, impartialement consulté, semble donner raison à l’opinion traditionnelle. » En effet, « je retrouve le premier [chemin] inchangé lorsque j’y reviens après avoir essayé les autres. On a beau me dire que, du fait de la durée, il doit y avoir un changement : je n’en aperçois point […] Comme un acteur devant une pluralité de rôles, j’ai affaire à des possibilités objectives. » Objectera-t-on que ces possibilités font figure de choses au sein de l’esprit ? « Et après ? Ce mot de chose dont certains philosophes [existentialistes] se plaisent à faire un épouvantail […] n’a pas de quoi nous effrayer. » Car si on veut dire que ces représentations sont « des réalités, et des réalités distinctes de l’esprit qui les pense », « c’est la vérité même et c’est exactement ce que l’on veut dire en les qualifiant de possibilités objectives. » Objectera-t-on que ces possibilités ne sont que nos propres sentiments, nos propres actions imaginées par avance ? « Assurément ! Qui ne sait qu’il appartient à la réflexion de placer en objet devant le je les tendances ou états les plus subjectifs du moi ? Et […] délibérer, [n’est-ce pas] d’abord réfléchir ? Nous avons donc devant nous, quand nous délibérons plusieurs objets possibles. Chacun de ces objets est constitué par une certaine conduite à tenir, conduite aboutissant à un certain résultat et s’inspirant de certains motifs. »
Aristote désigne par le mot de phronesis la vertu de bien délibérer. On traduit par « prudence ». C’est ce qu’on devrait plutôt appeler la « sagesse », comme y insistent Gauthier et Jolif : s’« il est certain qu’une filiation historique relie la « prudence » française à la prudentia latine et par elle à la phronesis grecque », il n’en reste pas moins que « le sens du mot de prudence a subi dans notre langue une évolution si forte et son sens est devenu si étroitement restreint qu’il ne répond plus du tout au sens plein de la phronesis grecque. C’est là un fait devant lequel il faut s’incliner ; on ne remonte pas le cours de l’évolution linguistique. » D’autre part, « ce serait prêter aux pires contre-sens que de traduire la sophia d’Aristote par le vieux mot populaire de « sagesse » ; il est hors de doute en effet que ce que nous appelons en français « sagesse », c’est, non ce qu’Aristote appelle sophia, mais ce qu’il appelle phronesis, il suffit pour s’en rendre compte de se reporter [à des] passages caractéristiques. Thalès et Anaxagore sont pour nous les types mêmes de ces philosophos sophoi, qui ne sont pas des sages, phronimoi, tandis que Périclès peut très bien passer à nos yeux pour le type du sage, phronimos: n’avons-nous pas eu, récemment, un comité des sages qui n’était pas un comité de philosophes, mais un comité d’hommes politiques, et le type du sage, n’est-ce pas aux yeux de tous les Français Gandhi plutôt qu’Einstein ou Bergson. C’est s’interdire de comprendre la phronesis aristotélicienne que l’appeler « prudence » – mot qui ne désigne en français qu’une réserve qui n’est même pas toujours vertueuse – alors qu’elle est une sagesse qui dirige toute la vie… » Mais Aubenque est d’un avis contraire : « Ce qui justifie humainement la délibération, malgré sa faillibilité insupprimable, c’est qu’une action idéale et « scientifique » se heurterait plus encore, faute d’en tenir compte, aux médiations rebelles de la matière et à l’imprévisibilité […] du temps. On voit que ce que nous entendons de nos jours sous le vocable de prudence n’est pas tellement étranger à ce qu’Aristote attendait du bon bouleutokos. »
Communication au Colloque de la faculté de droit de tours 2010