Blanchot et Nietzsche
Blanchot et Nietzsche
Version complétée en novembre 2023
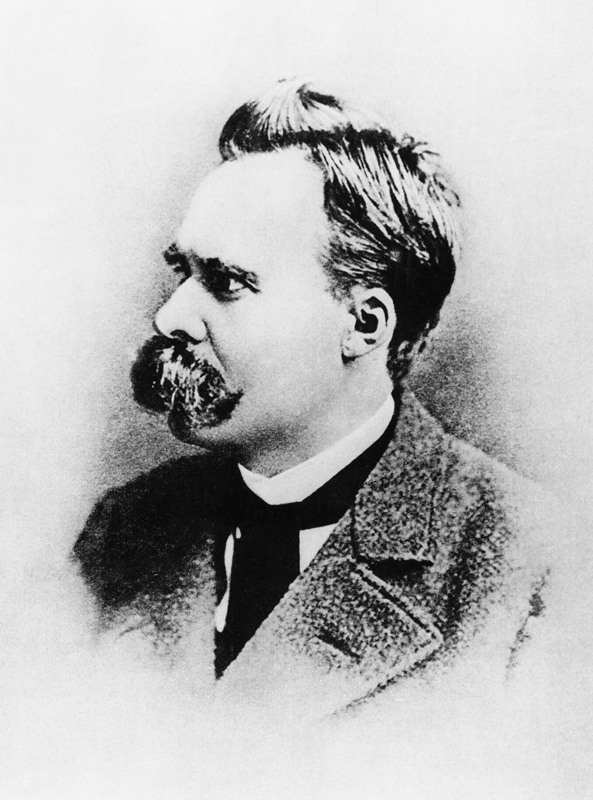
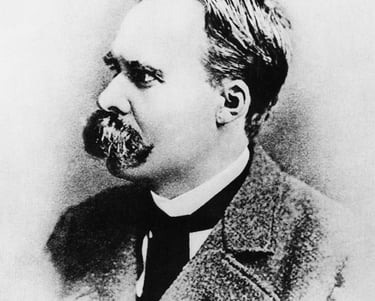
Les titres de deux des récits de Blanchot - Le Dernier Homme et Au Moment voulu - semblent tirés d’Ainsi parlait Zarathoustra, du premier Discours du Sage et de celui sur « la mort volontaire » : « Meurs au moment voulu » - c’est la traduction que Blanchot donne de « Stirb zu rechten Zeit ». Cela témoigne sans aucun doute que leur auteur se sentait proche de Nietzsche. Ce témoignage est cependant étonnant, car la tonalité de ces récits n’a rien à voir avec les Discours de Zarathoustra. Surtout, dans L’Espace Littéraire, Blanchot a critiqué la recommandation nietzschéenne de la mort volontaire. On ne peut donc pas ne pas se demander ce que, à l’époque de ces récits, Blanchot a réellement pensé de Nietzsche. On peut espérer le savoir, parce que, à deux reprises, en 1945 et en 1958, Maurice Blanchot, germaniste et diplômé de philosophie, informa le public français des principaux ouvrages sur Nietzsche qui venaient de paraître en Allemagne, ceux de Jaspers, de Schlechta, de Heidegger et de Lukacs, Dans ces articles, plus ou moins objectifs, transparaît la pensée de leur auteur au sujet de Nietzsche lui-même, ce qu’il en retient, ce qu’il croit y voir, et ce qu’il refuse d’y voir.
I
Blanchot parla significativement de Nietzsche pour la première fois en 1943. Il le fit incidemment, à l’occasion d’un commentaire des conceptions morales de Montherlant. Il vit dans celles-ci « la vulgarisation du nietzschéisme, de ce qu’il y a de plus facile dans Nietzsche». Il pensait donc qu’il y avait dans ce dernier autre chose, quelque chose de moins facile, qui n’avait pas été ou n’avait pu être vulgarisé. Quoi donc ? Ce serait la reconnaissance du « non sens »: « Alors que Nietzsche jette un appel à la vie pure et inexplicable, à la vie sans justification et sans excuse, à la vie où la gloire de ce qui est périssable retire tout sens aux déterminations téléologiques, à un « en vue de » quel qu’il soit, Montherlant ne peut se tenir à ce non-sens qui fonde le tragique absolu et il assigne à la vie une fin, une raison… »
« La vie pure et inexplicable, la vie sans justification et sans excuse… » Blanchot reprenait ici les mots de Thierry Maulnier exposant la critique nietzschéenne du désespoir, d’après laquelle c’est de la vie qu’on doit faire la valeur suprême, de sorte que, si la morale n’est pas possible dans la vie, il faudrait conclure contre la morale, non contre la vie. Lorsque ensuite Blanchot déclarait que le non-sens fonde « le tragique absolu », il suivait en cela Maulnier qui opposait au désespoir le sentiment de « l’homme tragique », celui qui accepte ce qui conduit les autres au refus ou à la tentative d’une justification. Blanchot d’ailleurs ne se bornait pas à nier que la vie ait un but, pour lui tout but reniait le non-sens et réintégrait dans ce qu’il appelait la morale. Georges Bataille, de même, résumait sa philosophie dans ce paradoxe que le principal but que l’on puisse avoir était de détruire en soi l’habitude d’avoir un but.
Quoi qu’il soit, Blanchot voyait alors en Nietzsche un penseur de l’absurde. Quinze ans plus tard, il avait changé d’avis. C’est ce qui ressort d’une chronique dans laquelle il rendit compte de l’édition Schlechta des œuvres de Nietzsche. Dans le Nachtwort de cette édition, Karl Schlechta avait tenté d’exposer le thème de ces œuvres et d’après lui ce « thème fondamental et désespéré », c’est que le monde n’a pas de sens. Dans sa chronique, reprenant les mots de Schlechta, Blanchot exprima le même sentiment « d’une obsédante monotonie » : « Quelque chose de fondamental cherche à s’exprimer, un thème identique, non identique, une constante pensée… » Mais alors qu’on s’attend à ce qu’il formule la thèse de Schlechta, qui avait été la sienne en 1943, il ne le fait pas. Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? C’est sans doute la lecture du Nietzsche de Karl Jaspers.
II
En 1945 dans « Du côté de chez Nietzsche », Blanchot semble à première vue recenser l’étude sur l’athéisme de l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra que le Père de Lubac avait publiée dans le Drame de l’humanisme athée. D’après ce dernier, Nietzsche ne se serait pas borné à constater qu’il n’y a pas de bonnes raisons de croire que Dieu existe, il aurait choisi de nier cette existence parce que cette négation serait nécessaire à l’affirmation de l’homme. Blanchot rejette cette présentation, il lui reproche de n’avoir pas vu que le thème de la Mort de Dieu exprime « l’impossibilité de tout repos». Nietzsche n’aurait jamais nié définitivement aucune thèse, se contredire serait le mouvement essentiel de sa pensée, et sa négation de Dieu ne serait pas plus définitive que ses autres thèses: N’écrivit-il pas : « La réfutation de Dieu : en somme, ce n’est que le Dieu moral qui est réfuté. » Finalement la négation de Dieu n’impliquerait que l’affirmation de l’homme comme « puissance infinie de négation », autrement dit «l’insatisfaction sans mesure et sans limites.»
Au terme de son étude Blanchot reconnaît cependant l’existence d’un autre Nietzsche - ce qui semble d’ailleurs donner raison au Père de Lubac: « Dans un autre mouvement de sa pensée Nietzsche congédie définitivement Dieu. » Mais ce Nietzsche-là, il le rejette. Les notions qu’il emploie seraient minées par « les pires équivoques», par exemple celle de vie, celle de volonté de puissance. « Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce que la puissance ? Un plus que la vie ? Une Volonté de devenir plus, c’est-à-dire, à notre gré d’avoir une force plus grande ? » En particulier Blanchot reproche à la recommandation de la mort volontaire de « recommander l’impossible, liant ma décision à un moment que personne ne peut connaître, « le moment voulu », que je ne pourrais apercevoir qu’une fois mort… ».
Mais revenons au « premier » Nietzsche. Blanchot voit dans sa pensée l’illustration de la thèse sartrienne de l’homme comme puissance infinie de négation. Surtout, il découvre dans son expérience spirituelle l’exact équivalent de L’Expérience intérieure de Georges Bataille. Relisons en effet la première page de la recension qu’il en avait donnée en 1943. C’est le même déclaration de l’« impossibilité de tout repos », la même conception de l’homme comme « insatisfaction sans limites ». C’est la même exigence d’un constant dépassement et c’est cette condamnation de tout repos qui justifie le rejet de la foi en Dieu. De fait, Blanchot avait cité l’une des paroles qui précèdent l’enseignement de Zarathoustra au sujet de la Mort de Dieu au début de cette présentation de L’Expérience intérieure. Et au terme de son interprétation de l’athéisme nietzschéen il évoqua à nouveau Bataille, citant ce que ce dernier avait écrit dans « La folie de Nietzsche ». Rappelons qu’en 1945 l’auteur de la Somme athéologique venait d’en publier le dernier tome - intitulé Sur Nietzsche, dans laquelle il déclarait qu’à peu d’exceptions près sa seule compagnie sur terre était celle de Nietzsche. Cependant plus qu’à Bataille, c’est surtout à Karl Jaspers que Blanchot doit cette interprétation. C’est en effet Jaspers qui caractérise Nietzsche par « la critique impitoyable d’un dépassement qui ne s’arrête pas ». C’est Jaspers qui propose le principe de l’interprétation de Nietzsche que Blanchot adopte, à savoir que « l’autocontradicton » serait le trait fondamental de sa pensée . C’est Jaspers qui met en doute l’évidence de l’athéisme de Nietzsche et du moins affirme son ambiguïté C’est enfin Jaspers qui distingue deux Nietzsche, qui critique l’un des deux (la « métaphysique de la volonté de puissance ») et qui, en particulier propose une réfutation du « Meurs au moment voulu ».
L’interprétation de Nietzsche que donne Jaspers est-elle fondée ? Blanchot tenta de la justifier en soutenant - ce que n’avait pas fait Jaspers - que toutes les formulations de l’idée de la mort de Dieu (la parabole du fils du gardien de la prison du Voyageur et son Ombre, « l’Insensé » du Gai Savoir, etc.) sont ambiguës. En réalité, ces textes sont clairs, et Blanchot ne justifia ses interprétations qu’au prix de sophismes. Ainsi Nietzsche écrit dans Par-delà le Bien et le Mal qu’après le temps où l’homme sacrifiait à Dieu est venu celui où l’homme doit « sacrifier Dieu lui-même au néant » : Blanchot crut devoir juger la formule « équivoque » : « Dieu n’est pas seulement sacrifié à rien, mais le sacrifice est engagé dans ce rien, et, par conséquent, [il] n’est rien, [il] n’est pas, [il] n’a pas lieu. » Mais c’est la thèse de Jaspers elle-même d’une pensée nietzschéenne fondamentalement contradictoire qui doit être mise en question. Du moins, on peut proposer une solution du problème que pose le texte que cite Blanchot : « Au fond, seul le Dieu moral est réfuté » - il y a cet autre: « Vous dites que c’est une décomposition spontanée de Dieu, mais ce n’est qu’une mue ; il se dépouille de son épiderme moral. Et bientôt vous le retrouverez, - par-delà le bien et le mal. » Ces textes exposent le lien essentiel que Nietzsche croit devoir établir entre Dieu et la morale – il la fonderait. On peut alors comprendre le sens – l’un des sens - de son athéisme, à savoir l’affranchissement de la morale : « Ce n’est que depuis qu’il gît au sépulcre que vous êtes ressuscités ? C’est maintenant enfin […] que l’homme supérieur va être - le maître » - maître d’agir « par-delà le bien et le mal ». Et on peut aussi comprendre que l ‘« athéisme » de Nietzsche vise non tous les dieux mais le seul « Dieu moral », le Dieu biblique, celui des Tables de la Loi, comme l’atteste la conclusion d’Ecce Homo : « Dionysos contre le Crucifié. »
III
Jaspers avait d’autre part montré que sa philosophie de « la Vie », cette philosophie «sans transcendance », avait conduit Nietzsche à ôter à la mort « sa profondeur ». Blanchot reprit cette critique à la fin de son article de 1945, et il la développa en 1952, dans « La Mort possible ». Dans l’éloge nietzschéen du suicide, il y aurait, d’après lui, plus de politesse pour le monde des vivants que « d‘égards pour la profondeur de l’abîme » et à la conception nietzschéenne de la mort, il opposa la conception hegelienne de « la vie de l’esprit », celle « qui ne craint pas de se livrer à la dévastation de la mort mais la supporte, la soutient et se maintient en elle ».
Quels égards devrait-on à « l’abîme » - c’est-à-dire, semble-t-il, aux souffrances et à la dégradation de l’agonie ? L’apologie de l’euthanasie, que Nietzsche fait dans Le Voyageur et son Ombre nous paraît, aujourd’hui, plus raisonnable. Quant à Hegel, par « la mort » on sait qu’il désignait l’analyse, le travail de l’entendement. Cependant, la philosophie qu’après Kojève Blanchot lui attribue a été soutenue, ce fut celle de Hobbes. Dans « La Littérature et le droit à la mort », c’est de la parole que Blanchot fait « la vie qui porte la mort et se maintient en elle», et réaffirme ainsi, probablement sans le savoir, la thèse la plus originale de l’anthropologie de Hobbes. D’après ce dernier en effet, le langage a pour conséquence de nous arracher à l’immédiateté du présent; il rend possible non seulement la rétention du passé mais la projection de ce passé dans l’avenir. C’est cela qui fondamentalement caractériserait l’homme, l’anticipation de l’avenir. Et c’est là aussi que commencerait son drame. Car à partir du moment où nous prévoyons l’avenir, nous prenons conscience que la mort nous menace et nous menacera toujours et que finalement nous serons vaincus. D’où, puisque nous ne tendons à rien d’autre qu’à persévérer dans l’être, une crainte immense, une crainte constitutive de la nature humaine elle-même.
Cette description est-elle exacte ? On peut en douter. Blanchot cite ce mot du Gai Savoir : « Je suis heureux de voir que les hommes se refusent absolument à vouloir penser à la mort ! » Laissons de côté la satisfaction qu’en tire Nietzsche. N’a-t-il pas raison dans la constatation du fait ? Spinoza l’a d’ailleurs expliqué. Ce dernier pense, comme Hobbes, que les hommes ne désirent qu’une chose : persévérer dans leur être. Mais pour lui cela ne veut pas dire conserver sa vie à tout prix, cela veut dire actualiser les conséquences de son essence, c’est-à-dire faire jusqu’au bout ce à quoi notre nature nous détermine. La crainte de la mort n’est donc plus, de ce point de vue, à la racine de toutes les motivations humaines. Les hommes, certes, s’inquiètent pour leur avenir, mais contrairement à ce que pense Hobbes, ils ne sont guère affectés par un futur très éloigné et se rassurent vite. Loin de toujours vivre dan l’angoisse, ils passent donc, bien plutôt, par des alternances de crainte et d’espoir. Les situations désespérées sont exceptionnelles.
Spinoza condamne ceux qui entretiennent la crainte de la mort. Nietzsche se réjouit de leur échec. Mais lui, il est de ceux qui ne peuvent pas ne pas penser à la mort : «… Et pourtant la mort et le silence de la mort sont les seules certitudes qu’ils aient tous en commun ! Comme il est étrange que cette seule certitude, cette seule communion soit presque impuissante à agir sur les hommes et qu’ils soient si loin de sentir cette fraternité de la mort ! » .
IV
Dans son second article, Blanchot invoque à nouveau Jaspers pour souligner que la philosophie de Nietzsche ne se présentait pas sous la forme d’un « système ». Est-ce à dire qu’elle ne soit pas systématique ? Lukacs l’a nié, distinguant la cohérence d’une pensée et le caractère systématique de sa présentation. Et d’après lui « le point central autour duquel convergent les pensées de Nietzsche, c’est la contre-attaque contre le socialisme, la lutte pour créer une Allemagne impérialiste. » Lukàcs fonda cette interprétation sur une série de textes impressionnants.
L’inquiétude de Nietzsche au sujet d’une possible révolution socialiste est de fait explicite et constante. En 1871, dans une lettre à son ami le baron von Gersdorf, Nietzsche, évoquant la Commune de Paris, lui écrit : « Notre mission allemande n’est pas encore finie […] Au-delà du combat entre nations nous avons été effrayés par cette tête d’hydre internationale qui tout à coup est apparue de façon terrible, annonçant pour l’avenir de toutes autres luttes. » En 1872, à la fin de La Naissance de la Tragédie il exprime à nouveau sa crainte d’une révolution socialiste : « Le jour où l’effet de ses belles paroles enjôleuses et lénifiantes sur la « dignité de l’homme » et la « dignité du travail » se sera usé, la civilisation alexandrine s’acheminera progressivement au-devant d’un horrible anéantissement, ira peu à peu au-devant d’un horrible anéantissement. Il n’y a rien de plus terrifiant qu’une classe servile et barbare qui a appris à considérer son existence comme une injustice et qui se prépare à en tirer vengeance. » Et en 1888 dans L’Antéchrist il déclare : « Qui sont, parmi la canaille d’aujourd’hui, ceux que je hais le plus ? [C’est] la canaille socialiste […] ceux qui rendent [le travailleur] envieux, qui lui enseignent la vengeance. »
Quant à la « contre-attaque », elle est proposée aussi explicitement. Dans « L’Etat chez les Grecs », Nietzsche se fonde sur l’exemple de la société antique pour soutenir la nécessité de l’esclavage : « Pour que l’art puisse se développer sur un terrain fertile, vaste et profond, l’immense majorité doit être soumise à l’esclavage […] Elle doit à ses dépens et par son sur-travail dispenser [la] classe privilégiée de la lutte pour l’existence […] C’est du manque d’esclavage que nous périrons ». En 1878, dans Humain trop humain, il réaffirme la nécessité de l’esclavage : « Il ne peut naître de culture supérieure que là où il existe deux castes tranchées de la société : celle des travailleurs et celle des oisifs, aptes au vrais loisirs » et l’oppose à la protestation des socialistes contre l’injustice. En 1886 dans Le Gai Savoir, il déclare réfléchir à un « nouvel esclavage » : « Nous réfléchissons à la nécessité d’un ordre nouveau, et aussi d’un nouvel esclavage, car pour toute élévation du type « homme » il faut une nouvelle espèce d’asservissement. » La nécessité de ce nouvel esclavage est encore rappelée en 1888 dans Le Crépuscule des Idoles: « Il faut complètement renoncer à l’espoir de voir se développer une espèce d’homme modeste et frugal, une classe qui répondrait au type du Chinois ; et cela eût répondu à une nécessité.» Comme on voit, Nietzsche, sur ce point, ne se contredit pas, seule change la tonalité de l’expression, mesurée en 1878, optimiste en 1884, désespérée en 1888.
On objectera qu’il faudrait encore démontrer que cette question soit le centre des pensées de Nietzsche. C’est vrai. Revenons donc un instant au problème de son athéisme : Zarathoustra associe Dieu et l’égalité : « Devant Dieu, [disent-il], nous sommes tous égaux. – Devant Dieu ! Mais ce Dieu est mort. Mais nous refusons d’être égaux devant la populace. » De fait, « ce » Dieu est celui du christianisme, et ce qu’il reproche à ce dernier, c’est l’idée de « l’égalité des droits », comme cela ressort de cette page de L’Antéchrist : « Le Premier chrétien […] lutte toujours pour l’égalité des droits » « Le poison de la doctrine des « droits égaux pour tous », c’est le christianisme qui l’a répandu le plus systématiquement […] Cette calamité, née du christianisme, s’est infiltrée […] dans la politique.[…] Si c’est de croire aux prérogatives du plus grand nombre qui fait les révolutions et en fera encore – c’est le christianisme, n’en doutons pas […] que toute révolution transpose dans le sang et dans le crime. » Quant à l’immoralisme de Nietzsche, à sa réhabilitation de l’égoïsme et de la cruauté, et à son apologie du criminel, comment ne pas les rapporter à sa politique quand on lit ce que proclame Zarathoustra dans ce qui devait être la fin de l’ouvrage : « Je vous ai tout pris, Dieu, le devoir, - à présent vous devez donner la plus grande preuve de noblesse. Car la voie est libre pour les scélérats ! voyez ! – la lutte pour le pouvoir, à la fin le troupeau plus troupeau que jamais et le tyran plus tyran que jamais […] Les conséquences de mon enseignement feront nécessairement de terribles ravages : mais innombrables sont ceux justement qui doivent en mourir… »
De l’étude de Lukàcs Blanchot rend compte en disant que « c’est une mise en accusation ». Il allait de soi, pour lui, qu’elle n’était pas fondée. Et de La Destruction de la Raison, dont l’étude sur Nietzsche constitue un chapitre, il dénonce le caractère « polémique ». Lukàcs recherche par quels chemins l’Allemagne, dans le domaine de la philosophie, en est arrivée à l’adhésion à l’hitlérisme et est devenue la patrie d‘élection des ennemis de la raison. «… C’est vrai », écrit Blanchot en 1958, « il faut défendre la raison. Mais la raison n’a pas peur de l’irrationalisme qui, même voulant son échec, peut lui ouvrir la voie d’une plus grande raison. Le livre est important, il faudra y revenir. » Blanchot n’y reviendra pas, et supprimera cette note dans L’Entretien infini.
En réalité, l’irrationalisme que dénonce La Destruction de la Raison n’a rien à voir avec celui auquel semble penser Blanchot. Lukàcs condamne, d’abord, des philosophes qui ne sont plus capables ni désireux d’étudier vraiment leur adversaire pour tenter de le réfuter sérieusement. D’après lui l’arbitraire, la contradiction, les arguments sophistiques, etc., caractérisent de plus en plus les philosophes modernes, et c’est d’après lui le cas de Nietzsche: « L’arbitraire « génial » et son caractère superficiel […] apparaissent quand on compare Nietzsche aux philosophes classiques. » Lukàcs rejette ensuite les thèmes de l’irrationalisme, à savoir la dépréciation de l’entendement et de la raison, la glorification sans mesure de l’intuition, une théorie de la connaissance aristocratique, le rejet du progrès historique de la société, la création de mythes.
Quels sont en effet les arguments de Blanchot pour dénoncer « une falsification sinistre, mais simpliste et superficielle, comme toute falsification politique »? C’est d’abord, que la pensée de Nietzsche est une « pensée essentiellement libre ». Mais que cette pensée soit « libre », cela signifie seulement qu’on n’a pas le droit de l’enrôler, cela n’exclut pas qu’on ait de bonnes raisons de savoir sous quelle bannière il pourrait l’être. Ensuite Blanchot répète (presque textuellement) Schlechta d’après qui, si Nietzsche a sa part de responsabilité dans la « catastrophe », ce serait au premier chef parce que sa sœur, ivre d’ambition, avait brandi l’étendard de son frère sur les débuts du Reich qui devait durer mille ans. Non seulement Hitler n’aurait eu aucune idée de Nietzsche mais les commentateurs officiels eux-mêmes ne s’y seraient pas réellement intéressés - Blanchot rapporte à ce sujet un témoignage peu concluant de Schlechta. Mais à ce sujet Lukàcs rappelle cette évidence qu’on n’a en aucun cas besoin d’avoir lu un philosophe pour être influencé par lui dans sa vision du monde. Il existe une littérature secondaire, il y a des articles dans les revues et dans les journaux. Blanchot invoque enfin l’autorité de Heidegger d’après qui les interprétations politiques de Nietzsche ne sont possibles que si on « aplatit » sa pensée. Mais Heidegger dépolitise Nietzsche contre l’évidence des textes. Ainsi, dans « De la Ligne » il enseigne que « Nietzsche entendit un Appel qui exigeait la préparation de l’homme à l’entreprise d’une domination de toute la Terre… » En fait, il ne s’agit pas d’une domination de l’homme, au sens où Descartes annonce que nous pourrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais de la domination de certains hommes sur d’autres. Nietzsche écrit en effet : « Le temps approche où il faudra lutter pour la domination de la terre, et cette lutte sera menée au nom de principes philosophiques. » Il envisage bien une domination politique puisque dans le même fragment il souhaite que « l’Allemagne s’empare du Mexique », puisque dans un autre fragment il parle de l’Europe et envisage un ennemi : « Si elle veut entrer dans de bonnes conditions dans cette lutte [pour la domination de la terre]– on voit bien contre qui sera dirigée cette lutte - l’Europe aura sans doute besoin de s’« entendre » avec l’Angleterre.» Blanchot accepta cette interprétation sans la discuter, en dépit de son caractère arbitraire. Quant à l’accusation que Lukàcs fondait sur des textes indiscutables, il n’y répondit pas. Mais qu’aurait-il pu répondre ?
Le cas de Blanchot, à vrai dire, n’a rien d’exceptionnel. Ainsi, récemment, Jean-Paul Dollé a pu rapprocher le rejet nietzschéen de la démocratie de celui de Marx. Daniel Colson a pu, en dépit de textes explicites, rapprocher Nietzsche des anarchistes. Certes Colson admet que ces derniers peuvent difficilement se reconnaître dans des formulations où Nietzsche prend sans cesse le parti des « forts » et des « maîtres». Mais d’après lui on percevrait « mieux aujourd’hui comment, pour Nietzsche, maîtres et esclaves constituent des types, applicables à un grand nombre de situations », et que « maîtres et esclaves ne sont pas toujours là où on croit les trouver. »
Cet étonnant refus de considérer la politique de Nietzsche éclatait déjà dans un hommage à Hölderlin de 1950, dans lequel Blanchot déclarait voir en Nietzsche «Hölderlin qui revient encore une fois » - sans doute à cause du « mythe de Dionysos [et du] mythe de la Grèce». A l’opposé de Blanchot, Lukàcs estima que la Grèce de Hölderlin n’a rien de commun avec « l’hystérie bestiale que Nietzsche a introduite dans l’image de la Grèce». L’hellénisme de Hölderlin serait, selon Lukàcs, plutôt analogue au culte de la République romaine des révolutionnaires français que Marx a signalé au début du Dix-Huit Brumaire. De fait, à la fin d’Empédocle, le héros répond aux citoyens d’Agrigente qui lui offrent la couronne : « Ce n’est plus le temps des rois », et il prêche l’idéal d’un renouveau révolutionnaire radical de l’humanité: « Ce que la bouche de votre père vous a enseigné, Loi et coutumes, les noms des dieux anciens, Oubliez-les hardiment et levez, tels des nouveaux-nés, Votre regard vers la divine Nature… » Cette Nature, d’après Lukàcs, est celle de Rousseau et de Robespierre, elle est le rêve d’une transformation de la société qui rétablit l’harmonie de l’homme avec elle, avec une société qui redevient donc naturelle. Cette interprétation peut paraître forcée, et le jugement sur « l’hystérie bestiale » de La Naissance de la Tragédie exagéré. Mais c’est un fait que Hölderlin écrivit une Ode à Rousseau et qu’il s’enthousiasma pour la Révolution française, alors que Nietzsche traita Rousseau de « tarentule morale » et qu’en 1871 il célébra la victoire de la Prusse comme une victoire sur le « libéralisme » de la Révolution française qu’il déclara « haïr comme le véritable adversaire de toute profondeur philosophique et esthétique .» Nietzsche et Hölderlin expriment donc bien, sous une même forme mythique, des pensées opposées. Or Blanchot sait que, au contraire de ce qu’il fait lui-même, Lukàcs oppose à Hölderlin « l’hystérie bestiale » de Nietzsche, puisqu’il cite ce mot – mais il n’essaie même pas de le discuter.
V
Dans la dernière page de la première partie de l’article se manifeste, à la suite de la combinaison de commentaires de Schlechta et de Heidegger, un thème souvent latent chez Blanchot – ce que j’appellerai l’apocalyptisme. Dans cette page en effet, il loue la lucidité de Nietzsche, qui aurait discerné le nihilisme de la science: « Celui qui veut la science, doit aussi vouloir aussi les conséquences de la science, doit donc vouloir à la fin le nihilisme : c’est là l’avertissement que Nietzsche a donné…» Et il voit une justification de cet avertissement dans le « danger » effectif auquel, « aujourd’hui », elle nous exposerait: « Au moment où nous nous apercevons tout à coup et avec quelle surprise, que le danger auquel nous expose le savoir n’est pas un danger de style, et où en même temps nous nous efforçons, et avec quelle hypocrisie, de conserver tous les avantages de la science, mais en en refusant les risques, il y aurait peut-être intérêt à faire appel au courage conséquent et à la probité impitoyable de l’esprit de Nietzsche. » Dans la chronique suivante Blanchot revient sur les relations de la science et du nihilisme - cette fois, c’est d’après lui la science qui serait la conséquence du nihilisme. Et il loue Nietzsche d’avoir prévu - non pour le déplorer – que le destin du monde allait reposer dans les mains des hommes de science. Un peu plus loin, il revient sur le danger que court l’humanité : « La connaissance est foncièrement dangereuse. Nietzsche a donné de ce danger la formule la plus brutale : « Nous faisons une expérience avec la vérité ! Peut-être que l’humanité en périra ! Eh bien soit. » Voilà, d’après Blanchot, ce que les hommes de science auraient dû dire, mais ils auraient été assez hypocrites pour déplorer une catastrophe qui serait pourtant l’une des « issues » de la science. En 1964 enfin, dans sa recension du livre de Jaspers La Bombe atomique et l’Avenir de l’Homme Blanchot cita le même texte de Nietzsche en dénonçant à nouveau « l’hypocrisie » de celui qui veut la science sans accepter ses conséquences.
«Nous faisons une expérience avec la vérité, peut-être l’humanité en périra-t-elle… » Assurément, lue après le 6 août 1945, cette formule paraît prophétique. Mais il suffit de se reporter au fragment posthume complet que cette phrase conclut pour s’apercevoir que cette mort de l’humanité y est le résultat possible de l’enseignement de Zarathoustra qui appelle à une guerre civile apocalyptique: «… Les conséquences de mon enseignement feront nécessairement de terribles ravages, mais innombrables sont ceux justement qui doivent en mourir. Nous faisons une expérience avec la vérité. Peut-être fera-t-elle périr l’humanité ? Allons-y. » Blanchot a sans doute lu la dernière phrase, isolée, dans l’ouvrage de Jaspers, qui commet un contre-sens analogue au sien.
Nietzsche a-t-il vraiment dit que le nihilisme est la conséquence de la science ? Dans La Généalogie de la Morale, il dit seulement que la science moderne est « pour l’instant le meilleur auxiliaire de l’idéal ascétique » dont le nihilisme est l’un des plus « hauts degrés », et dans une dizaine d’aphorismes sur « les savants » de Par-delà le Bien et le Mal il insiste - avec la plus pénible condescendance - sur ce rôle d’auxiliaire. En réalité, dans cette page Blanchot suit l’analyse que Schlechta donna de l’œuvre de Nietzsche dans le Nachwort de son édition. C’est Schlechta qui soutient que la philosophie de Nietzsche est essentiellement une conscience des conséquences de la science et une farouche résolution de la prendre au sérieux. C’est Schechta qui voit dans l’œuvre de Nietzsche un « avertissement » au sujet de la science. C’est Schlechta qui crédite Nietzsche d’avoir saisi les traits nihilistes essentiels de la méthode scientifique. En effet la question du sens échappe au domaine scientifique. Or le nihilisme serait partout où il n’y a plus de sens. Par conséquent la science serait nihiliste, elle ne pourrait que « détruire les valeurs». C’est aussi Schlechta qui inspire Blanchot lorsqu’il rend hommage à la « probité » de Nietzsche et déplore notre « hypocrisie ». D’après lui Nietzsche aurait été nihiliste et il l’aurait été parce qu’il acceptait les sciences, le monde ne lui aurait semblé dépourvu de sens que parce qu’il lui serait apparu « dans la lumière blême de la connaissance […] acquise par les sciences naturelles et expérimentales», mais nous, nous ne serions ni assez honnêtes ni assez logiques pour voir que la méthode scientifique nous sépare « de toute réalité vivante et vierge. »
Comme on le voit, le Nachwort de Schlechta est le point de départ de la réflexion de Blanchot sur la science. Mais alors que Schlechta envisage les conséquences éthiques de la science (le « nihilisme », la destruction des « valeurs ») et les déplore, Blanchot envisage les conséquences matérielles (la perspective de l’annihilation, de la destruction de l’humanité) - et ne semble pas les déplorer, en tout cas il loue Nietzsche de ne pas les déplorer et d’en accepter le risque.
En réalité, Nietzsche n’a jamais envisagé le problème des applications de la science ni évoqué « la prodigieuse puissance de la technique». Qu’est-ce d’ailleurs qui le lui aurait suggéré ? « La presse, la machine, le chemin de fer, le télégraphe », toutes ces inventions sont dues à des hommes dont les connaissances scientifiques étaient très limitées. Nietzsche a seulement dit que les « victoires de la science moderne », par exemple celle de Copernic, « n’aboutissaient qu’à détruire en l’homme l’antique respect de soi». Cette idée qu’il n’a pu lire dans Nietzsche, Blanchot la doit à Heidegger d’après qui l’auteur de Zarathoustra poserait le problème de « la domination de la Terre ». Et il la combine avec celle, fréquemment évoquée par Nietzsche, du danger mortel que constitue une vérité qui détruit les « illusions vitales », et qu’il a une fois dramatisée en lui imputant la mort de l’humanité : « Peut-être […] l’humanité périra-t-elle à cause de [la] passion de la connaissance.» Cette idée d’un danger de la connaissance – non de la science - s‘exprime d’ailleurs dans de nombreux fragments posthumes, par exemple ceux qui varient le thème mythique du Minotaure au fond de son Labyrinthe. Et le thème de la mort de l’humanité apparaît, lui aussi, dans plusieurs autres fragments posthumes.
Qu’est-ce que nous révèlent ces lectures au sujet de Blanchot lui-même ? C’est certes, d’abord, sa passion pour la philosophie, pour la philosophie contemporaine. Voilà un écrivain qui va lire dans le texte, en 1945, l’ouvrage de Jaspers sur Nietzsche, en 1958 ceux de Schlechta et de Heidegger. Ce qui est ensuite remarquable, c’est que sa lecture n’est pas critique, il ne confronte pas les interprétations dont il rend compte à l’œuvre interprétée, au contraire, systématiquement il radicalise les interprétations proposées. Ainsi, quand Jaspers affirme l’ambiguïté de la Mort de Dieu, Blanchot entreprend d’établir l’idée du philosophe allemand, quitte à forcer les textes les plus univoques. Et quand Schlechta croit pouvoir établir qu’au fondement de la pensée de Nietzsche il y a une réflexion sur la science, il prolonge cette idée, jusqu’à lire dans Nietzsche une prophétie de l’autodestruction de l’humanité par l’arme atomique. Ce qu’il faut enfin constater, c’est la prédilection de Blanchot pour les philosophies irrationalistes. Il est tout de même significatif qu’il revienne si souvent au penseur qui a pu être considéré comme le fondateur de l’irrationalisme moderne, et qu’il ne réponde pas au philosophe qui le dénonce. Certes, en ce qui concerne l’irrationalisme politique, Blanchot se borne à défendre Nietzsche contre ceux qui l’accusent d’avoir anticipé le nazisme, mais il ne se prononce pas sur la pertinence de la critique que Nietzsche adresse aux libéraux, aux démocrates et aux socialistes. Est-ce à dire que Blanchot reste fidèle à ses conceptions politiques d’avant-guerre ? Je crois plutôt qu’il ne s’intéresse pas à cet aspect de la pensée de Nietzsche. Déjà Thierry Maulnier, le chef de file de la Jeune Droite, avait en 1935, avait écrit un livre sur Nietzsche sans jamais y faire la moindre allusion à la pensée politique de l’auteur. Blanchot a donc pu rejeter cette politique sans rejeter l’irrationalisme philosophique qui en est solidaire. C’est ce que manifeste l’interprétation qu’il donne du thème de la Mort de Dieu. Comme presque tous ses lecteurs, Blanchot a été attiré par la passion avec laquelle Nietzsche s’est déclaré athée. Mais il y a deux athéismes : l’un est fondé sur le développement des sciences de la nature, l’autre est ce que Lukacs a appelé un « athéisme religieux », et qui juge le premier « vulgaire ». On doit admettre que Nietzsche représente la forme la plus extrême de cet « athéisme religieux », même s’il certains textes relèvent du premier type d’athéisme, et Blanchot rejette ce qui chez Nietzsche est lié à « l’athéisme vulgaire ». C’est déjà ce qu’avait fait Jaspers, qui avait radicalisé le subjectivisme de Nietzsche. De ce point de vue on peut dire que c’est de la philosophie de Jaspers que, au moins à cette époque, Blanchot s’est senti le plus proche. Enfin, comme l’indique son souvenir des textes dans lesquels Nietzsche évoque la mort de l’humanité, Blanchot a de plus partagé avec lui certaines hantises, il a été comme lui sensible
A ce goût de périr qui prend la Pythonisse
En qui mugit l’espoir que le monde finisse.
Cette étude était destinée au numéro spécial de la Revue de Métaphysique et de Morale « Blanchot : écriture et philosophie ». Avril 2015. L’étude n’a pas été retenue.